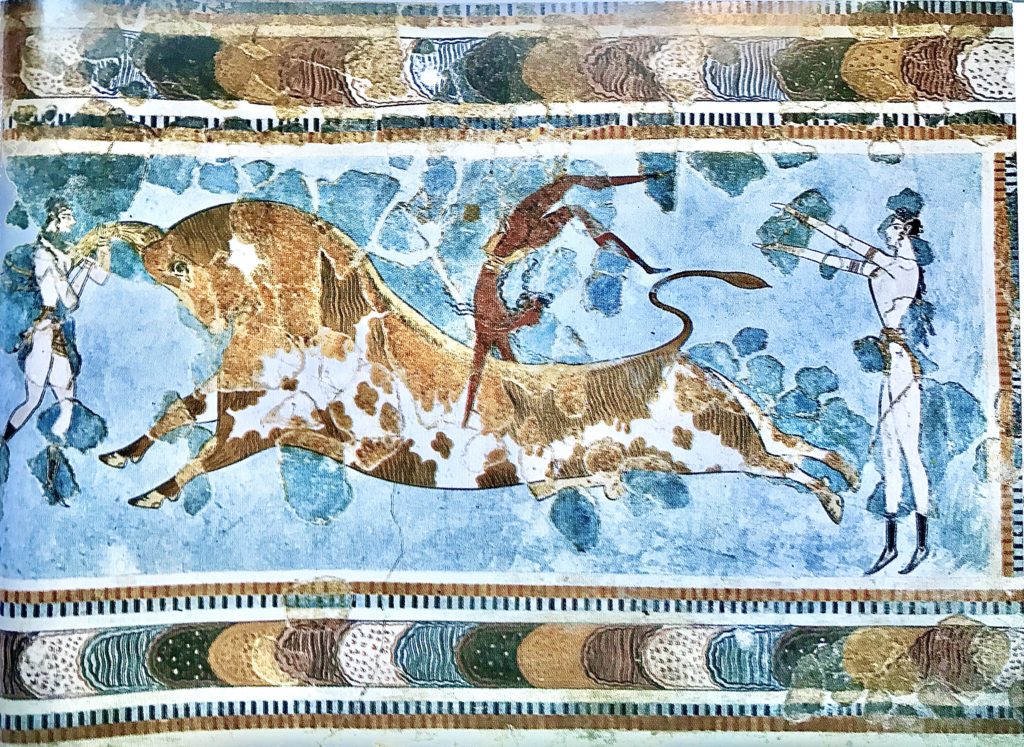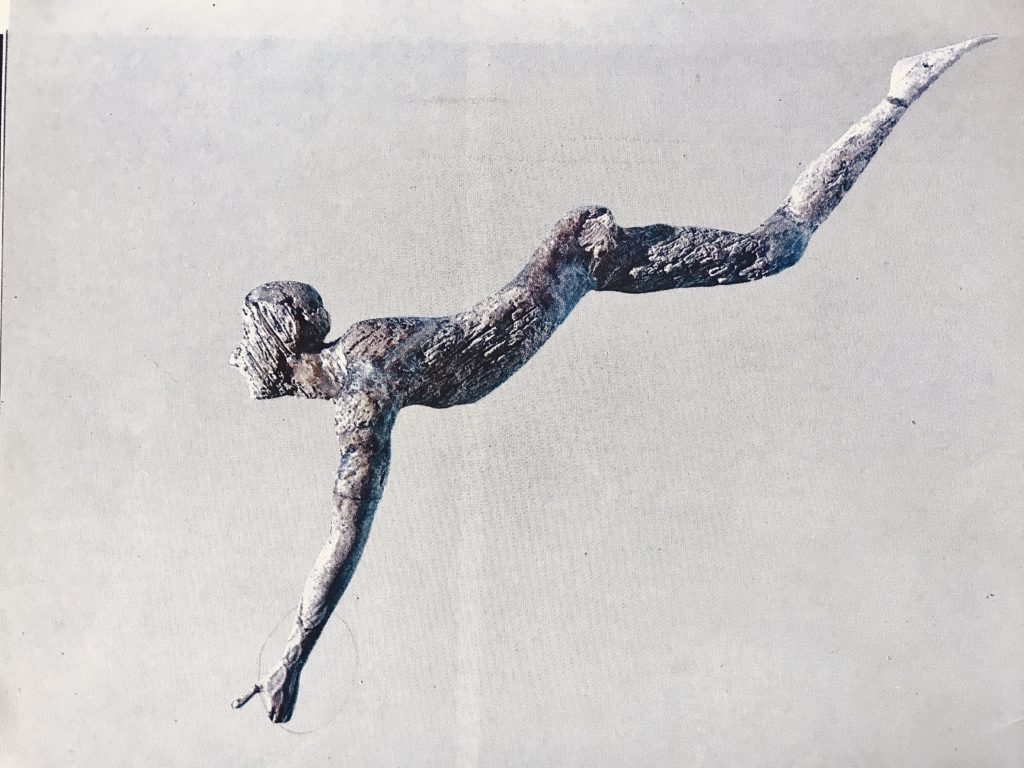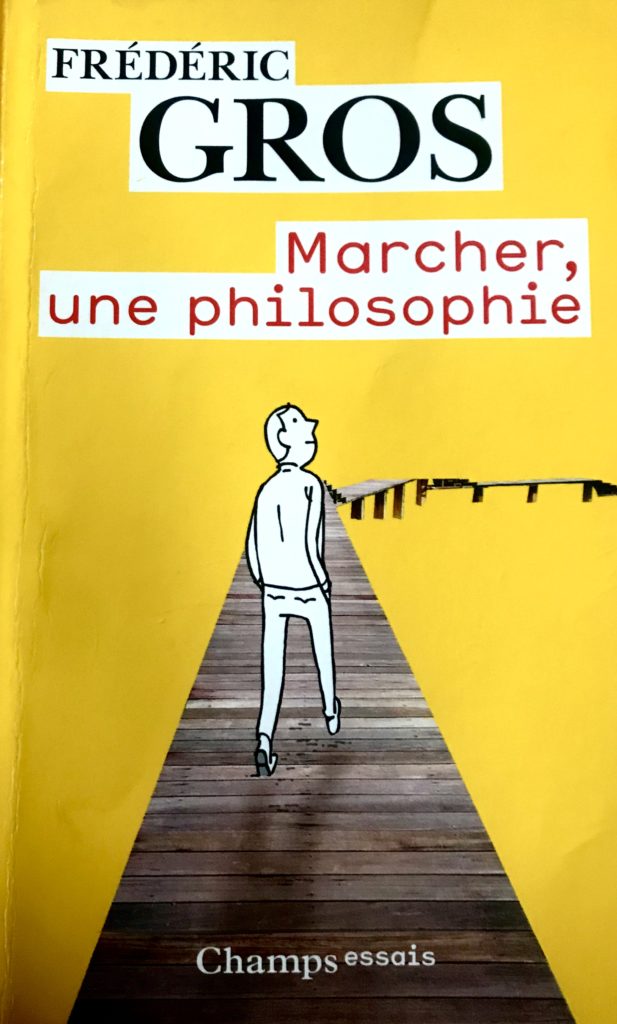L’authenticité, qu’est-ce que c’est ?
Que de mal on se donne avant de prendre son originalité chez soi, tout simplement. »
Notes sur le métier d’écrire, Jules Romain
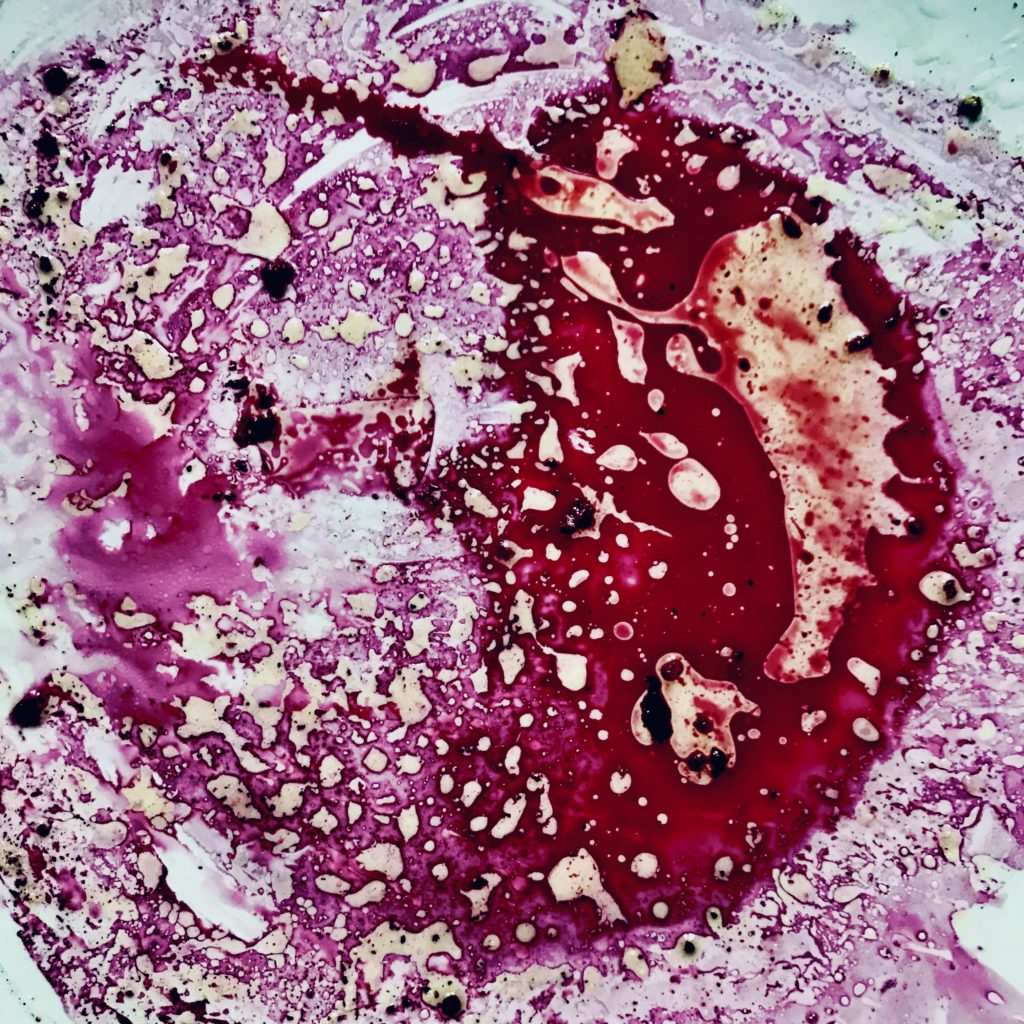
Du grec ancien authentikós : “se détermine par sa propre autorité”.
Qui au-delà des apparences, exprime, manifeste, reflète, une vérité profonde de l’individu et non des habitudes superficielles, des conventions.
Qui est de façon certaine l’œuvre de telle personne (auteur, artiste) : non altéré, pur.
Son être le plus vrai, sa personnalité la plus profonde.
Être authentique, c’est donner de la profondeur à ce que l’on fait.